
 Bop-Pills voulait célébrer les 70 ans de Roberto Piazza (aka Little Bob) avec une interviouve du plus sincère des rockers français depuis Noël Deschamps, et aussi tenter une chronique du nouvel album de Little Bob Blues Bastards : “Howlin”. Qui vient de sortir. Et qui est une véritable tuerie. Un condensé du vécu du havrais.
Bop-Pills voulait célébrer les 70 ans de Roberto Piazza (aka Little Bob) avec une interviouve du plus sincère des rockers français depuis Noël Deschamps, et aussi tenter une chronique du nouvel album de Little Bob Blues Bastards : “Howlin”. Qui vient de sortir. Et qui est une véritable tuerie. Un condensé du vécu du havrais.
Pour faire d’une pierre trois coups, nous voulions aussi fêter ses 40 ans d’une carrière faite sans concession. Ou si peu !
Après une navrante constatation que le Net et la presse papier racontaient à peu près la même chose, nous avons sollicité une demande d’interviouve avec la louable intention de nous démarquer. Mais pas de retour, silence radio. Quelque chose aurait-il buggé sur l’Internet ?
Le désespoir commençait à nous gagner, lorsque – miracle ! – nous avons déniché par hasard un entretien passionnant que Bob a accordé en avril 2012 à l’excellent site “Blues Again”. C’est son histoire que l’enfant des docks (of the bay !) y raconte. Mais aussi sa rage, ses passions, ses désillusions. Ses projets – à l’époque les Blues Bastards -. Et le spleen.
Il y va même de deux couplets sur le rock français qui ne sont pas faits pour nous déplaire !
Bref, il se livre !
Et l’on s’aperçoit finalement que rien n’a changé chez Bob. Rien ? Si ! La couleur de cheveux !
Lectures, réunions, discussions. Et on a envoyé la demande de publication. Acceptée tempo par retour de mail !
Hal Véole
![]()
LITTLE BOB
Le blues des docks
On devrait créer une médaille de la ténacité rien que pour ce type. Roberto Piazza verse sa sueur et son sang à la noble cause du rock’n’roll. Increvable et indifférent aux quotas, modes et règles du show-biz, le seul rocker français à avoir donné plus de 300 concerts outre-Manche, continue de chanter le rock et le blues avec ce grain de voix très soul qui évoque Little Richard ou Eric Burdon. Au cours d’une interview bigrement émouvante, le Screamin’ kid du Havre se montre plus que jamais fidèle à son sacerdoce et à ses origines.
Blues Again : Te souviens-tu de ton premier disque de blues ?
Little Bob : Ma musique, comme dit l’autre, elle vient de là, elle vient du blues. Môme, j’ai échangé, au grand frère d’un pote – qui avait rencontré des marins américains – cinq 45-tours d’Hallyday contre quatre singles de Little Richard. Quand j’ai écouté ça, j’étais comme électrisé. Je crois que j’ai fait une bonne affaire ! Je suis un fan de blues de base.
Dès que j’ai commencé à écouter de la musique dans les années 60, je me suis aperçu que les groupes anglais comme les Stones, les Animals ou les Pretty Things étaient inspirés par le blues. Ils avaient des titres signés John Lee Hooker, Muddy Waters ou Robert Johnson. Je suis allé voir le disquaire, je lui ai dit : Si vous avez des disques de ces gens-là, j’aimerais bien en écouter ! Le premier que j’ai acheté était un album d’Howlin Wolf. Moi qui étais fan de Little Richard, d’Eric Burdon et des voix qui hurlent, on peut dire que j’étais bien tombé ! Je me souviens, c’était un vinyle à la pochette un peu bistre, rose fuchsia, avec la tête d’Howlin’ Wolf. Il comprenait “You’ll Be Mine’’, un titre que j’ai repris sur mon premier disque. Les Dr Feelgood l’ont repris l’année d’après. Je me rappelle qu’à l’époque, la presse anglaise, NME, Melody Maker, avaient noté quelque chose comme : « Une version pas mauvaise, mais pas aussi réussie que celle de Little Bob Story » ! Ça m’avait fait plaisir. C’est sûr, ma musique n’aurait jamais eu ce goût d’authenticité si je n’avais pas écouté Elvis, Little Richard et les groupes anglais comme les Animals ou les Small Faces qui reprenaient du rhythm’n’blues à fond.
Quels bluesmen écoutes-tu aujourd’hui ?
A l’époque du British blues boom, j’étais fan de John Mayall, Clapton et Cream. J’ai des albums de Peter Green, Eric Clapton, John Mayall qui sont infernaux. D’ailleurs, un de mes disques préférés est le Blues From Laurel Canyon. J’aime les gens qui sortent des sentiers battus. Je suis fan de Captain Beefheart ou de Tom Waits, même si je continue à écouter les vieux maîtres du blues comme Freddy McDowell ou Robert Johnson. L’autre jour, j’étais à Londres. J’entre au Virgin Megastore. Je monte à l’étage, puisque le blues, ils le classent avec le jazz, ce que je trouve un peu con : je verrais plutôt ça avec le rock. Bref. Dans l’escalier, j’entends une voix qui fait hum hum hum… Je suis immédiatement accroché. J’apostrophe un vendeur. C’est quoi, ça ? Il me répond : On vient de ressortir un album de Howlin’ Wolf remasterisé. J’ai dit : Ça, je le veux !
Puisqu’on en était à John Mayall, quels sont les artistes blancs qui ont su saisir l’âme du blues ?
Keith Richards est l’exemple parfait du rocker bluesman. Depuis ses débuts, il continue à jouer le même riff, le même genre de choses. Moi, je suis le même genre de mec que Keith Richards, je continuerai à faire de la musique jusqu’au bout, tant que j’en aurai la force. Mais musicalement, les Stones, c’est assez large. Avec des groupes comme Dr Feelgood ou Inmates, là, on parle d’une vie.
Le blues français, tu en penses quoi ?
Je chante le blues à ma manière. Ce blues à la française me gonfle souvent. Trois accords, douze mesures, toujours les mêmes…
Je ne comprends pas que les Français se mettent à faire du blues en pensant à Gary Moore. Il faut qu’ils descendent vers les racines, qu’ils écoutent les vieux ! Dans ces groupes français, généralement, il y a toujours un type qui essaie de jouer comme Steve Ray Vaughan. C’est ce qui m’exaspère le plus !
Parmi les titres que tu as composés, lesquels seraient les plus proches du blues ?
Il y en a beaucoup. Dans l’album Live In The Dockland, j’évoque mon quartier. Il change. C’est l’ancien quartier des docks. Des dockers, il n’y en a plus puisque aujourd’hui tout arrive par container. Les caissons sont directement transbordés dans des trains ou des camions. Donc tous les entrepôts sont en train de disparaître. Dans “Livin In The Dockland”, je vois des fantômes sortir des murs des entrepôts, je vois toute cette vie qu’il y avait avant, ces trucs pénibles qui se passaient à cet endroit… Les gens travaillaient dur, en même temps ils étaient heureux, ils gagnaient leur vie, quoi ! C’est aussi un côté du blues. Je te peux citer également “Alabama Pedro”, un blues-boogie écrit après un voyage au Nigéria. Alabama Pedro est un vrai bluesman que j’avais rencontré là-bas. Il avait un peu la tête de Robert Johnson. J’en ai fait un héros. Avec son bottleneck, il peut faire tomber le joug des militaires au Nigéria. Dans la chanson “Gift Of The Devil”, je chante : “The blues has a baby and his name is rock’n’roll”, avec un passage blues-shuffle et de la slide. Dans chacun de mes albums, il y a toujours un ou deux titres assez proches du blues.
Le blues, le spleen, pour certains, c’est la condition sine qua none de la création. Pour toi aussi ?
Les petits coups de blues peuvent donner de belles chansons, c’est vrai. J’ai écrit une de mes plus belles ballades, “Nobody’s Born To Lose”, alors que j’étais en plein blues. A ce moment-là, nous tournions sans arrêt en France et en Angleterre, nous avions donné plus de 350 concerts en quatre ans. On était donc tout le temps sur la route avec mon groupe. Un soir à Londres, notre manager nous demande si on veut manger chinois. J’avais envie d’être seul. Je suis allé manger une pizza à Soho. En fait, j’avais vraiment le blues. Je me sentais loin de chez moi. Je sentais bien l’amour de mes potes, mais ce n’était pas suffisant. Ma pizza terminée, j’ai demandé un bout de papier et un stylo avec le café. C’est là que j’ai écrit : “Sittin’down, drinkin’ a coffee, waiting for somebody to talk”, en pensant à la vie que je menais. Le blues, c’est peut-être la musique la plus facile à jouer… mais la faire ressentir, c’est autre chose. Il faut la vivre, l’avoir dans le cœur et dans l’âme. Ça, tout le monde ne l’a pas. Le vrai blues qui te blesse le cœur et qui te remue, c’est très difficile à donner. Pour le faire ressortir, il faut être profondément blessé. Avant, je faisais du rock’n’roll à fond, je ne faisais quasiment que ça, même s’il y avait quelques ballades dans lesquelles je donnais mon spleen. Je trouve que, depuis que j’ai souffert un peu plus de la vie, j’écris de plus belles chansons. La souffrance est un truc qui te fait grandir.

Comme beaucoup de bluesmen, tes chansons ont un fond autobiographique ?
Un titre qui m’est venu, c’est un morceau qui proclame : “Sunshine for Everybody”. J’y parle des mômes africains qui quittent leur pays, traversent la savane, les déserts, les océans, et débarquent dans ce qu’ils imaginent être le pays de cocagne, l’Europe. Ils se retrouvent à douze par chambre dans des taudis, et on les fout à la porte pour finir. Il y a un foyer à côté de chez moi. Je les vois, ces jeunes mecs qui croient avoir pris la bonne route et réalisent tout à coup qu’ils sont dans la merde. Surtout s’ils arrivent ici quand il fait froid ! Dans la chanson “Libero”, je parle de mon père. Ça aussi, c’est du blues. Mon père a émigré ici pour gagner sa vie. Ici, il gagnait un statut social plus important. Il était commerçant. Enfin, son père l’était. Lui, il a tout paumé. Il a voulu recommencer à zéro. Il a fait un peu comme ces Africains. Bon, il partait d’un peu moins loin. Quand on est blanc, on est mieux accepté même si, au départ, je me suis fait traiter de ‘macaroni’. Je suis arrivé en France, j’étais un jeune mec de douze ans et demi, je parlais italien… Je peux comprendre ce qui se passe quand tu n’es pas franchement le bienvenu. Dans mon cas, c’étaient des paysans normands un peu durs. Je partais d’Italie sous le soleil, j’arrivais au Havre, les pavés étaient mouillés, la semaine d’après il a neigé. On était en mars, c’était déjà le printemps. Avec ça, tu chopes tout de suite le blues ! Ceci dit, aujourd’hui, il fait beau au Havre !
Le blues et son côté passif, le rock’n’roll et sa révolte… Qu’en penses-tu ?
On ne peut pas dire que le blues soit vraiment une résignation. Les mecs prenaient leurs guitares, jouaient dans le bar de leur patelin, mais dès qu’ils en avaient les moyens ils partaient voir un peu plus loin. Ils n’acceptaient pas leur condition puisqu’ils allaient voir ailleurs. En France c’est pareil. Tu es musicien parce que tu n’acceptes pas ta condition, ni le chemin que la société a tracé pour toi. Pour moi, le rock’n’roll c’est toujours une violence à sortir.
Si tu rencontrais le diable à la croisée des chemins et qu’il te demandait ton âme…
… En échange de quoi ?
… De chanter mieux qu’Elvis et Little Richard réunis, par exemple…
Le diable, j’en parle souvent dans mes chansons. Il y a “The Devil And Me” dans Blues Stories, “The Gift Of The Devil” dans The Gift. Non, je ne lui vendrais pas mon âme pour un succès. Aujourd’hui, vendre son âme au diable, ce serait jouer du commercial, faire du pognon. Telles ne sont pas mes ambitions. J’essaie de faire un truc qui me plaise toujours, de rester en accord avec ce que je chante et ce que je joue. Le diable, je lui dirais : Écoute, j’ai beaucoup volé chez toi, je t’en ai assez piqué comme ça, l’alcool, l’imagerie et tout le reste, tu peux te barrer maintenant. On a tourné comme des dingues avec la Story. C’était vraiment sex and drugs and rock’n’roll ! Maintenant que je vieillis, j’ai moins besoin de ça. J’ai réussi à m’en sortir vivant, n’en déplaise à certains ! (Rires.) Je tourne à un rythme moins soutenu, je peux apprécier les bonnes choses, le bon vin, tout un tas de trucs qui ne m’intéressaient pas au départ. Maintenant, c’est la vie. Et j’aime la vie !
Donc, le personnage de l’artiste maudit et torturé, très peu pour toi ?
Entre nous… Des mecs comme Patrick Eudeline… J’ai rien contre, il écrit très bien, mais il ne dira jamais du bien de moi… parce que, pour lui, je suis trop vivant. Au départ, avec la Story, nous accordions plus d’importance à la musique qu’au visuel. C’est vrai, on n’était pas là à se recoiffer toutes les cinq minutes. Nous étions de vrais rockers. Pour Eudeline, le rock’n’roll c’est se fringuer d’une certaine manière, prendre de la dope… Il est un peu bloqué de ce côté-là. Prends maintenant un mec comme Daniel Darc. Il écrit bien, on sent qu’il est bourré de talent, mais le talent du côté sombre. Mes côtés sombres, je les garde pour moi, je ne les montre pas, j’essaie d’offrir aux gens une image un peu plus positive. La vie est tellement dure aujourd’hui ! Ce malaise, tu le ressens dans la rue, dans le métro… J’essaie d’être positif, oui, mais voilà : la chanson que je préfère sur The Gift, c’est “No Future Is Now“. C’est un peu dur, ça va à l’encontre de ce que je viens de dire, mais, bon, c’est la vérité. Le no future des punks, c’est vraiment maintenant.
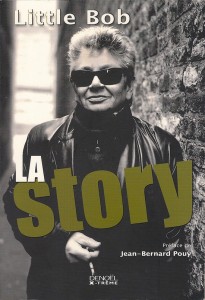 No future, c’est aussi une expression qui pourrait s’appliquer à l’industrie du disque, non ?
No future, c’est aussi une expression qui pourrait s’appliquer à l’industrie du disque, non ?
Je suis du signe du taureau, j’aime bien avoir les pieds sur terre. Ce métier n’est vraiment pas fait pour les taureaux. On ne sait jamais ce qu’on va devenir ou de quoi demain sera fait. Je fais en sorte que le lendemain soit toujours avenant, je me bats pour ça mais ce n’est pas évident. Les disques se vendent de moins en moins. Aujourd’hui, il est devenu très difficile de se produire dans des salles un peu importantes. Comme je me produis actuellement, je n’ai plus le soutien d’une grosse boîte de disques, donc je fais comme je peux. Dans le temps on pouvait encore espérer faire une télé, aujourd’hui ce n’est plus possible. Attention, je n’en éprouve aucun regret, je m’en fous. Tant que je peux faire ma musique, prendre mon pied, je suis content. Un peu comme les vieux bluesmen. Mais pour remplir des salles importantes, il faudrait être un peu plus médiatisé que je ne le suis. Par contre, j’ai des fans un peu partout qui n’échangeraient aucun de mes disques contre n’importe quelle autre production très diffusée…
Le meilleur concert de blues auquel tu aies assisté…
Memphis Slim ! J’étais allé l’écouter à l’occasion d’une fête étudiante. J’avais 16 ans. Je m’étais faufilé dans la foule et m’étais retrouvé au pied du piano. Pour terminer sa prestation, il demandait au public ce qu’il aimerait entendre. J’ai crié : “My Babe” !. Crac, il a envoyé “My Babe”. Je criais : “Shake Rattle And Roll” !. Crac, il embrayait là-dessus. C’était une vraie claque !
N’as-tu jamais été tenté de faire un album 100 % blues ?
Un pur album de blues, tout le monde l’a fait. A une époque je me produisais en formule piano solo. Nous avons donné 150 concerts. Je chantais du blues et le pianiste jouait plutôt jazz. J’ai bien aimé faire ça, mais certaines choses me gênaient. Par exemple, le pianiste avait du mal à faire une pompe sur son clavier, façon Little Richard ou Fats Domino. C’est vrai que beaucoup de gens m’ont demandé de tirer un disque de cette expérience. En fait, si tu fais bien attention, les reprises du second CD de mon disque (The Gift) sont proches de celles de mon premier album (High Time, 1976). Il y avait “You’ll Be Mine“, un titre de Willie Dixon que chantait Howling Wolf. Eh bien là, c’est “Back Door Man”. Sur le premier disque il y avait “Lucille”, là il y a le “Bama Lama Bama Loo” de Little Richard. J’ai toujours repris “All Or Nothing” des Small Faces, et là je fais “Watcha Gonna Do About It”. Tu vois, je suis resté fidèle à mes racines et aux groupes que j’aimais quand j’ai démarré !
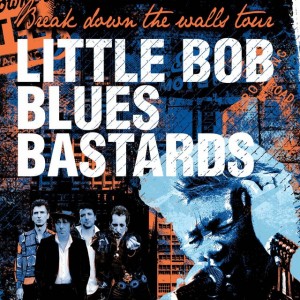 Mais il y a à présent les Blues Bastards…qui sont-ils et quels sont les projets ?
Mais il y a à présent les Blues Bastards…qui sont-ils et quels sont les projets ?
Depuis longtemps j’aime le Blues. Mon inspiration vient depuis le début des musiques blacks, même le rock’n’roll venait du blues. Ce nouveau projet se nomme Little Bob Blues Bastards, poussé par le souffle du Delta, avec un blues décalé original et sauvage. Avec mes musiciens on a un répertoire où se mélange mes créations et des standards (Howling Wolf, Skip James, JB Lenoir, Tom Waits, Captain Beefheart…) Les musiciens sont Gilles Mallet à la guitare, Bertrand Couloume à la contrebasse, Jérémie Piazza a la batterie et Mickey Blow à l’harmonica. Nous allons enregistrer ensemble le premier album de Little Bob Blues Bastards qui devrait sortir à la fin du printemps ou au début de l’été 2012.
Après la musique, le cinéma. Comment s’est faite la rencontre avec Aki Kaurismäki et que retiens-tu de ta participation au film Le Havre (le tournage, les rencontres, le festival de Cannes…) ?
Aki m’avait vu joué en 1978 en Finlande avec Little Bob Story. Son premier assistant, Gilles Charmant, avait tous mes disques et lorsqu’il est venu au Havre nous nous sommes rencontrés. Ses premiers mots ont été “Roberto, you are a rebel like me“. Tout s’est enchainé avec la promesse de me faire monter les marches à Cannes. Ça s’est passé comme dans un rêve et c’était évidemment formidable. Je garderai pour Aki Kaurismäki, et pour toujours, amitié et respect éternels.
Pascal Duval pour le site BLUES AGAIN
![]()






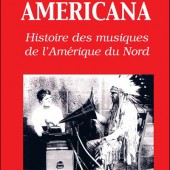
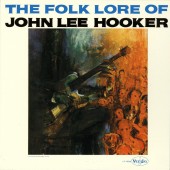


@ Little Bob !
Merci de l’intérêt que tu nous portes et ta lecture approfondie des commentaires qui sont la substantifique moelle des blogs ! C’est vrai que des fois, j’ai tendance à jeter le manche avant la cognée.
Nous venons de voir aussi ton acceptation d’ interviouve pour laquelle Bop-Pills est toujours OK. On te contacte et nous nous mettons d’accord pour une chaleureuse rencontre parisienne !
Keep on Boppin’ On
Ouèche !
Prof.
@Hal Véole-merci pour ta chronique. Pas vu de demande d’interview que je ne refuse jamais. Quand tu veux c’est possible. Rock on ! Bob
@Professor. Tu t’y connais. Je me suis effectivement inspiré de cette phrase puisque je l’ai mise dans ma chanson “Gift of the devil” et je n’ai surtout jamais dit que je l’avais écrite. Il m’arrive souvent de dire sur scène que cette phrase venait de la chanson de Muddy Waters “The blues had a baby and they name it Rock’n’Roll”. La musique n’est pas la même.
Little Bob.
Le Bob…. l’immense…. ce qui nous est arrivé de meilleur depuis 35 ans…et une fois encore…la France est passée à côté. Longue vie à notre Bob.
Lille Bob nous dit donc dans cette interview qu’il a écrit dans “Gift Of The Devil”, enregistré en 2005, cette ligne :“The blues has a baby and his name is rock’n’roll”.
Mais, entre nous, elle rappelle étrangement le titre d’un morceau de Muddy Waters : “The Blues Had A Baby And They Name It Rock’n’Roll” sorti sur l’album “Hard Again” (1977) du dit Muddy accompagné par rien moins que, c’est parti :
– Johnny Winter : guitars, back. vocals,
– James Cotton : harmonica,
– Pinetop Perkins : piano,
– Bob Margolin : guitar,
– Charlie Calmese : basse,
– Willie “Big Eyes” Smith : drums & percussions.
Et bien sûr : Muddy Waters : vocals, guitar.
Ouèche !
Prof.